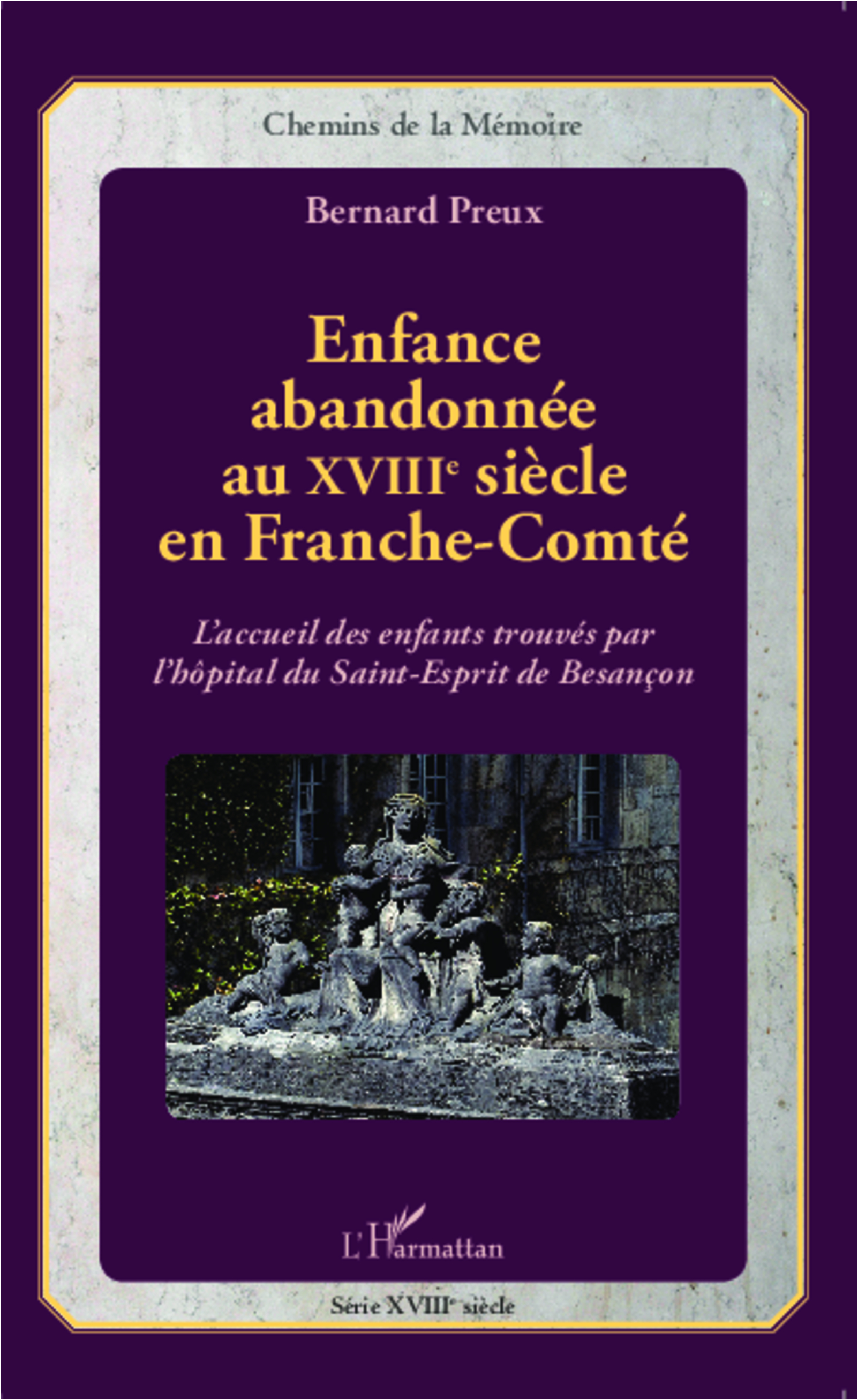C’est un bébé accroché à la corde de la cloche de l’église. Une petite fille de trois jours seulement dont les linges grossiers qui l’empaquettent ont été noués au seul fil qui la retient désormais à la vie. Nous sommes le dimanche 28 février 1723, dans le village de Scey-en-Varais (aujourd’hui Scey-Maisières), près d’Ornans dans le Doubs. Le nourrisson, qui vit encore, est découvert peu avant la messe, à l’heure où le bedeau s’apprête à battre le rappel des ouailles pour l’office dominical. Et si, la veille sans doute, les haillons servant de couffin au nouveau-né ont été de cette façon arrimés à la corde de la cloche, c’est pour une raison bien simple : sa mère voulait à toute force que son enfant, qu’elle a abandonné, soit découvert et qu’il vive. Amené à l’hôpital du Saint-Esprit de Besançon, qui accueille des centaines d’enfants trouvés, le bébé vivra. Quelques jours peut-être. Quelques mois, quelques années s’il a beaucoup de chance…
Au XVIIIe siècle, les Lumières n’éclairent pas encore les vallées franc-comtoises encaissées, ni les faubourgs grisâtres de Besançon qui s’étendent au rythme d’une industrialisation naissante. Et les enfants sont peu de chose. Avec une mortalité infantile, en 1740, de 30 % avant le premier anniversaire, les parents doivent en concevoir beaucoup pour en garder quelques-uns, qui aideront aux champs ou ramèneront un salaire. Mais l’existence est rude et les mauvaises fortunes fréquentes. Parfois le drôle devient un fardeau dont on se débarrasse. Le 13 avril 1711, on trouve ainsi à la porte de l’hôpital une nommée Marie-Anne Le François, fille de 5 ans dont le père est soldat partant sur le Rhin avec son bataillon. Même destin pour cette fillette de deux mois amenée de Pontarlier le 28 mai 1708, dont la mère, précise le registre d’entrée du Saint-Esprit, « est morte en couches et le père un soldat nommé Beauclaire ».
Bien sûr, à cette époque, la contraception n’existe pas et la morale est rigide. Alors quand une servante troussée à la hussarde a le malheur de tomber enceinte, elle porte en elle tous les péchés de l’univers. Même punition divine pour la femme infidèle ou la jeune fille de bonne famille débauchée par un moins-que-rien. La grossesse des filles-mères est cachée comme une maladie honteuse. Et la marmaille née de leurs amours interdites subira sa vie durant le poids de l’infamie. Comme l’infanticide est sévèrement réprimé, on abandonne à tour de bras, en « exposant » le bébé pour qu’on le trouve. Ici dans une église, là sous la porte cochère d’un employé de l’hôpital, plus loin sur l’itinéraire quotidien d’une patrouille de fantassins…
« Tout ça se passait il n’y a pas si longtemps », note Bernard Preux. « Les choses ont bien changé depuis. Et même si on abandonne encore les enfants aujourd’hui, et si on en trouve régulièrement nés de parents inconnus, il existe une différence fondamentale entre le XVIIIe siècle et l’époque actuelle : maintenant, l’enfant est reconnu en tant que personne. Il est écouté, il a voix au chapitre, il doit être protégé. Avant, c’était juste un individu en plus petit, qui se débrouillait comme il pouvait… »
Bernard Preux a été le premier à s’intéresser à un fait historique jusqu’alors peu étudié : les abandons d’enfants en Franche-Comté et leur accueil à l’hôpital du Saint-Esprit de Besançon. Il en a fait le sujet de sa thèse. L’œuvre de toute une vie pour cet universitaire de 65 ans, qui n’a longtemps possédé pour tout diplôme… qu’un modeste CAP. Travailleur social, il avait en charge le placement d’enfants dans les familles. Par le biais de la formation continue, dans les années 80, Bernard Preux obtient peu à peu des diplômes universitaires en sciences sociales. Bientôt armé d’un DEA, cornaqué par le Professeur Maurice Gresset, il entame sa thèse et passe le plus clair de son temps à dépouiller les archives du Grand Séminaire, puis les archives départementales à Planoise. Résultat : 67 années de registres de l’hôpital du Saint-Esprit épluchées, saisies sur ordinateur, et une thèse de quelque 450 pages…
L’ouvrage passionnant qui en est tiré a pour décor principal le bel édifice qui se dresse encore place de la Révolution, face au marché couvert à Besançon. Si l’endroit a abrité récemment le commissariat puis la présidence de l’université, le portail qui subsiste témoigne de sa destination première : une allégorie de pierre montre une nourrice donnant le sein à cinq enfants potelés…
La réalité, on s’en doute, était bien différente. Au XVIIIe siècle, l’hôpital du Saint-Esprit n’est rien de moins qu’un mouroir, d’où les enfants n’ont que bien peu de chances de ressortir. « L’ordre des hospitaliers du Saint-Esprit est né au XIIe siècle à Montpellier », raconte Bernard Preux. « Il a rapidement essaimé partout en Europe, et particulièrement à Besançon, avec cet hôpital bâti au XIIIe siècle, sous l’impulsion du chevalier Jean de Montferrand, cadet de la maison de Bourgogne. On venait de loin y apporter des enfants trouvés, de Vesoul, de Belfort, de Dole, de Suisse… »
Les premiers siècles de fonctionnement de l’orphelinat sont mal connus, faute d’archives. Mais celles du XVIIIe siècle donnent une idée de son ampleur : Bernard Preux estime à environ 11.000 le nombre d’enfants accueillis ici en 67 ans… Soit 17.000 abandons en 100 ans, ce qui représente une entrée tous les deux jours. Les moines et les sœurs qui administrent l’hôpital n’ont guère de compétences en médecine pédiatrique. « Ce qui leur importe », sourit l’universitaire, « c’est surtout de baptiser les enfants, car ils ne savent pas toujours s’ils l’ont été avant leur abandon. Il fallait à tout prix leur éviter d’errer dans les limbes pour l’éternité… »
Et si les petits doivent en urgence faire l’objet du saint sacrement, c’est qu’en arrivant à l’orphelinat, leurs jours sont comptés. Le taux de survie est en effet estimé entre 10 et 20 %. L’hygiène est déplorable, les maladies fatales, les conditions de vie terrifiantes. Dans son livre, Bernard Preux évoque ces réclamations écrites des moines de l’hôpital à leur hiérarchie : la pièce où ils ont coutume d’entasser les cadavres des enfants en attente de leur enterrement étant toujours pleine, ils se plaignent de mauvaises odeurs qui s’en échappent…
En ces temps anciens, et pourtant si proches, pas de lait en poudre ni de petits pots. Pour alimenter les moutards, l’hôpital fait venir sur place un bataillon de nourrices, qui allaitent les plus jeunes orphelins en l’échange d’un maigre pécule. Là encore, dans une hygiène toute relative, où les germes se transmettent des seins aux enfants à la vitesse de l’éclair.
Bientôt, devant des abandons toujours plus nombreux, le Saint-Esprit devient trop exigu. L’idée est alors émise, par les autorités, d’un placement d’enfants à domicile, à la campagne. « Dans les hôpitaux, il arrive que les enfants soient mal soignés et il en périt un grand nombre », écrit ainsi le contrôleur général du royaume en 1740. « Ceux qui survivent y sont élevés dans une habitude de paresse […] qui les rend inutiles à tout. J’ai pensé que l’on trouverait peut-être des fermiers qui voudraient s’en charger depuis l’âge de 7 ans jusqu’à 20 ou 25 ans. Ce serait un serviteur auquel on ne paierait point de gage ».
Une sorte d’esclave, on le voit, dont l’usage ne séduit pourtant guère certains « subdélégués », sortes de gouverneurs de province. Celui de Lure écrit : « De tout temps, ces bâtards ont porté la peine du péché de leurs pères, comme les juifs portent l’infamie de leur déisme ». Et celui d’Arbois renchérit : « Ils s’adonnent au libertinage et débauchent les autres. Une fille de cette espèce n’eut pas plus tôt atteint l’âge de 16 à 18 ans qu’elle accoucha d’un enfant ».
Malgré ces réticences fortes, un vaste réseau de plusieurs centaines de nourrices établies tout autour de Besançon, surtout dans les vallées du Doubs, de la Loue et de l’Ognon, se met peu à peu en place. Et si certaines étaient louées pour les bons soins qu’elles portaient à leurs protégés, d’autres étaient à l’évidence des matrones uniquement intéressées par la pension que l’hôpital du Saint-Esprit leur versait. « Lorsque l’enfant mourait chez la nourrice », écrit Bernard Preux, « celle-ci amenait un acte de décès à l’hôpital, afin qu’on lui verse la pension pour le temps qu’elle l’avait gardé ». L’occasion, parfois, de désaccords importants, comme pour cette dame, en 1789, suspectée d’avoir déclaré plusieurs fois le décès du même enfant…
Certains orphelins avaient parfois la chance de s’en sortir et d’atteindre l’âge adulte. Beaucoup d’entre eux étaient leur vie durant employés à la ferme qui les avait accueillis, d’autres étaient même adoptés. L’avènement de la République, les progrès scientifiques et sociaux, feront évoluer rapidement la prise en charge des enfants abandonnés vers plus d’humanité. « C’est intéressant de voir comment peu à peu les choses se sont mises en place jusqu’au système moderne », analyse Bernard Preux.
La Révolution, elle, coupera le cordon ombilical entre l’orphelinat et les religieux. Seule subsiste encore aujourd’hui cette devise, inscrite dans la pierre : « Mon père et ma mère m’ont abandonné, Dieu m’a recueilli ».
Enfance abandonnée au XVIIIe siècle en Franche-Comté – un livre de Bernard Preux – Editions L’Harmattan – 300 pages – 30 €.
Contact : bernard.preux@free.fr
Source : Serge LACROIX pour L’EstRepublicain.fr du 03/04/2016.